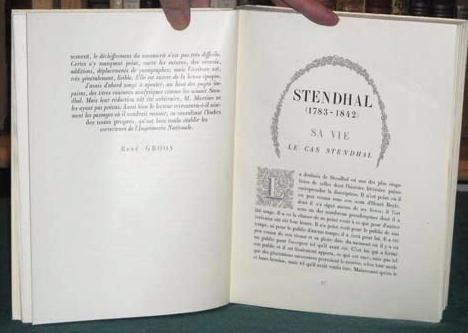mardi 17 mai 2011
Violences faites aux femmes : le déni ? (Viol en littérature et affaire DSK)
Par admin, mardi 17 mai 2011 à 19:40 :: Billets d'humeur (relative)
J.F Kahn : imprudence ou viol de DSK par pensetouseul
L'affaire DSK me paraît assez révélatrice du traitement que la société française réserve, en général, au thème du viol. Cela fait quelques années maintenant que je me penche sur la question, notamment par le biais de la fiction. Azima la rouge et Suicide Girls en traitaient de manière très instinctive, sans élaborer de théorie ni faire de morale. Il s'agissait de réfléchir à la notion de traumatisme, le viol représentant une sorte d'archétype de toutes les violences possibles. Et j'ai souvent été frappé par le mouvement de répulsion que provoquait ce genre de littérature : "Pourquoi donc écrire là-dessus ? / Le thème ne m'intéresse pas ! / Ecris donc des choses joyeuses ! / Nous n'avons pas envie de publier des articles sur un livre de cette catégorie-là."
J'étais surtout surpris de remarquer ces réactions chez des femmes, en majorité, alors que je m'étais attendu à ce qu'elles constituent un public privilégié. Les rares qui ont lu et aimé Suicide Girls m'ont semblé être des personnes qui avaient été touchées, de près ou de loin, par de telles choses, ou qui s'y étaient déjà intéressées. Et je me suis souvent donné l'impression d'être moi-même plus féministe que la plupart des femmes dans la mesure où j'éprouvais davantage de compassion, davantage de révolte face à la réalité d'une certaine condition féminine.
(On peut imaginer, bien sûr, des hypothèses à ce mouvement de répulsion : sujet sensible entre tous, fatalisme, caractère insupportable de certains faits que l'on sait pouvoir nous concerner...)
C'est le même genre de mouvement que je crois pouvoir observer dans l'affaire DSK. Sans vouloir bien sûr préjuger de la suite des événements, il est d'ores et déjà frappant de voir combien la question de la victime est évacuée. On ne la voit pas, mais surtout on ne veut sans doute pas la voir. Le vrai traumatisme, pour l'opinion publique et la classe politique, c'est de se rendre compte qu'il existait peut-être une autre réalité derrière la façade prestigieuse. Cela dérange tous les plans. Il est tellement plus facile, tellement plus confortable de s'en tenir à ce que l'on croyait être la réalité de DSK ! On hésite entre reconnaître la souffrance de la victime et préserver sa jolie vision des choses. Mais on n'hésite pas longtemps, en fait. A moins que les faits nous obligent un jour, par leur étalage éclatant sur la voie publique, à reconsidérer le paysage.
(Non pas que le public et la classe politique refusent de voir une réalité dont nous ne savons même pas encore si elle existe... Mais ils souffrent d'avance à l'idée qu'une réalité de cet ordre puisse éclater).