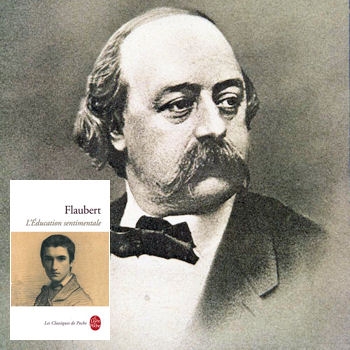Pour ouvrir la saison 5 de ce blog, et avant de parler littérature, je vous livre ce compte-rendu de deux conversations particulièrement saisissantes tenues cet été, dans l’aéroport chinois de Canton, alors que j’attendais, pendant seize heures, mon vol en direction du Vietnam – un bien curieux aéroport où le moindre café coûtait 10 dollars.
Ce fut la seule fois pendant ce voyage où j’entendis parler de la France, de la part de personnes n’y habitant pas, et j’ai été frappé par les fantasmes que ce pays génère et par la similitude de ces fantasmes chez des gens pourtant très différents. Je reproduis ces conversations sans faire commentaire.
La première, très brève, avec un Français en transit vers l’Australie.
« Vous vivez là-bas ?
– Oh oui, Sydney ! Franchement, la France, c’est plus possible… Ma femme a eu peur en voyant Paris. Il faut la comprendre, elle est australienne… Les Halles, Barbès, tout ça… L’horreur ! C’est plus Paris, c’est le Maghreb. En Province, ça va encore… Y’a encore des coins tranquilles. Mais Paris, c’est foutu… La France, c’est foutu. C’est trop tard, maintenant. Il faut partir, pendant qu’il est encore temps.
– Diriez-vous que vous êtes raciste ?
– Raciste ? Oui, bien sûr ! C’est naturel, d’être raciste ! J’en suis fier ! Quoi de plus normal ? »
J’ai laissé cet homme rejoindre son terminal, entamant alors une seconde conversation avec un groupe de quatre Américains, cette fois-ci, deux couples de septuagénaires et de quadragénaires, qui attendaient avec moi leur avion vers le Vietnam. Le premier homme se disait détective à la retraite (spécialisé dans les preuves de prostitution, à New York), le second ingénieur chez AT/T.
« Vous êtes français ? Oh, merveilleux ! C’est un si beau pays, la France… Mais si cher ! Dites-nous, nous aimerions avoir votre sentiment sur ce qui se passe dans votre pays… Il y a quelque chose qui nous inquiète beaucoup, voyez-vous. Nous en entendons souvent parler, chez nous. Il s’agit de nombre grandissant de Musulmans en Europe. Nous avons très peur qu’ils prennent le pouvoir. En fait, c’est inéluctable. Ils sont déjà si nombreux, ils font beaucoup plus d’enfants que nous… Vous auriez dû réagir plus tôt. Il y a quinze ans. Mais c’est trop tard, et nous avons vraiment peur… S’ils prenaient le pouvoir en Europe, ça nous ferait des alliés en moins, vous comprenez. Ce n’est pas un problème racial (nous sommes passés à une époque post-raciale), c’est vraiment un problème de religion, car l’Islam a des ambitions politiques.
– Je ne pense pas que l’Islam prendra le pouvoir en Europe. Ce n’est pas quelque chose que nous craignons, chez nous.
– Vous devriez, peut-être…
- Vous dites ça, mais le multiculturalisme est une notion que l’Europe importe des Etats-Unis. Vous me dites craindre l’Islam, mais Obama fait souvent pression sur l’Europe pour qu’elle soit plus libérale en termes de religion.
– Oh, vous savez, nous détestons Obama ! C’est une pure création du Parti Démocrate. Par exemple, il n’y a aucune preuve qu’il ait effectivement suivi des cours à l’Université. Personne n’est en mesure de produire le moindre document là-dessus.
– J’ai lu son livre,
Les mémoires de mon père… Une belle autobiographie ! Et puis il est bon orateur, non ?
– Son livre, il ne l’a pas écrit. Vous savez pourquoi ? Ses livres sont écrits de façons si différentes qu’il s’agit d’une plume différente à chaque fois, c’est évident. Quant à ses talents d’orateur, ils sont plus que discutables. Il n’est bon qu’avec un prompteur, en fait.
« Pour tout vous dire, nous pensons que le niveau général est en baisse… La presse aux Etats-Unis verse complètement dans le politiquement correct car elle est aux mains de quelques groupes financiers. Il n’y a plus de réelle démocratie, aujourd’hui. Tout est maîtrisé par des gens comme George Soros, qui n’est d’ailleurs pas pour rien dans l’ascension d’Obama.
« Ce que nous reprochons surtout à Obama, c’est de faire des Etats-Unis un pays socialiste. Par petites touches, il modifie profondément notre Nation. Nous devenons un pays d’assistés ! Aujourd’hui, vous avez droit à 99 semaines d’indemnités chômage. 99 semaines ! C’est absurde ! Et la moitié de la population ne paie pas d’impôts. Notre Amérique à nous, celle à laquelle nous croyons, c’est celle de l’initiative individuelle, la foi dans l’action, l’incitation à agir, à créer grâce à la récompense de l’argent. Les USA, ce sont les libertés individuelles.
« Regardez ces deux Chinoises, par exemple, qui tiennent ce restaurant. Elles attendent le client. Aux Etats-Unis, nous serions déjà en train d’aller vers le client potentiel pour l’inciter à venir dans notre établissement !
« On entend des choses terribles, sur la France… Il paraît que dans la rue les enfants avec une kippa sont poursuivis et frappés par de jeunes Musulmans. Le problème des Musulmans, c’est qu’ils n’acceptent pas de côtoyer des gens différents. Si tu veux qu’on te respecte, alors respecte-moi… Il faut affirmer son identité. C’est une chose qui existe, l’identité, il faut la défendre, ne pas la laisser se faire grignoter. En Irsaël, par exemple, la paix est assurée par une défense extérieure perpétuelle. Si celle-ci tombait, vous savez, Israël serait immédiatement détruite… On déteste aussi Obama pour ça : il avait promis de soutenir Israël mais il a préféré défendre la Palestine… »
Nous en sommes restés là. Ce sont les deux seules conversations du voyage que j’ai cru bon mettre sur papier – les seules vraiment spectaculaires, en fait. Après, je me suis laissé porter par la beauté de Ha Long ou le charme du vieil Hanoï…