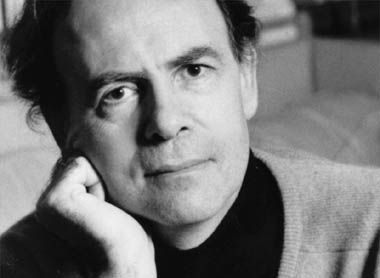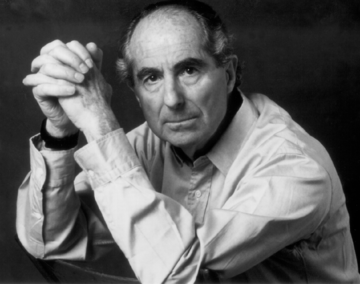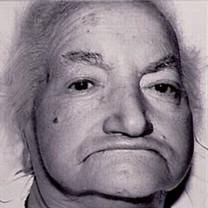mercredi 20 février 2008
"La joyeuse insolence d'un jour" (Javier Cercas, A la vitesse de la lumière)
Par admin, mercredi 20 février 2008 à 11:14 :: Littérature étrangère
(Outre le problème du temps pour essayer de rendre compte d'un minimum de lectures, il y a le problème du budget consacré aux livres (si mes calculs sont bons, ces derniers mois je n'ai pas acheté moins d'un livre par jour en moyenne) et celui de la place (je vais bien devoir me débarrasser de quelques kilos).
Dans cette masse effrayante, il y a parfois de singulières pépites qui se détachent, et nul doute que le roman de Javier Cercas, A la vitesse de la lumière (Babel, janv 2008), aura été l'une d'elles au cours de l'année 2007-2008: une prose fluide, précise, souvent belle, pour cette histoire émouvante d'une amitié entre un romancier espagnol bientôt submergé par le succès, et un vétéran du Vietnâm traumatisé par ce qu'il a commis (les événements les lieront de façon dramatique, comme il se doit).
Le thème n'est que moyennement tentant, et les cinquante premières pages un peu longuettes, mais bientôt c'est la force du récit qui vous happe et la succession de réflexions tour à tour brillantes et touchantes. Du bel ouvrage, parfaitement maîtrisé.
"Bien des années plus tôt, Rodney m'avait prévenu et, même si j'avais interprété alors ses paroles comme l'inévitable sécrétion moralisatrice d'un perdant imbibé de l'écoeurante mythologie de l'échec qui gouverne un pays obsédé jusqu'à l'hystérie par le succès, j'aurais au moins dû prévoir que personne n'est vacciné contre le succès et que ce n'est qu'au moment de l'affronter qu'on comprend que c'est non seulement un malentendu et la joyeuse insolence d'un jour, mais que ce malentendu et cette insolence sont humiliants." (p186)
Profitons du fait que le narrateur de ce roman se laisse souvent bercer par la musique de Van Morrison pour glisser ici-même l'un des plus grands tubes de ce grand artiste de rythme and blues (mâtinée de pop et de rock), trop méconnu à mon goût, et que j'ai découvert grâce à un duo avec M.Knopfler :