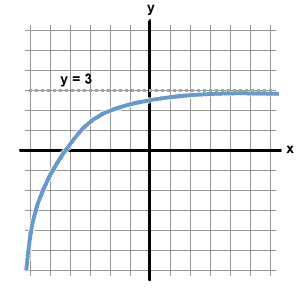mercredi 26 novembre 2008
Soyons désinvoltes, n'ayons peur de rien (Autoportraits de Houellebecq et BHL en ennemis publics)
Par admin, mercredi 26 novembre 2008 à 18:39 :: Essais / Philo / Témoignages
L'ouverture du livre est un coup de génie :
"Spécialiste des coups foireux et des pantalonnades médiatiques, vous déshonorez jusqu'aux chemises blanches que vous portez. Intime des puissants, baignant depuis l'enfance dans une richesse obscène, vous êtes emblématique de ce que certains magazines un peu bas de gamme comme Marianne continuent d'appeler la "gauche-caviar" (...). Philosophe sans pensée, mais non sans relations, vous êtes en outre l'auteur du film le plus ridicule de l'histoire du cinéma.
Nihiliste, réactionnaire, cynique, raciste et misogyne honteux : ce serait encore me faire trop d'honneur que de me ranger dans la peau ragoûtante famille des anarchistes de droite ; fondamentalement, je ne suis qu'un beauf. Auteur plat, sans style, je n'ai accédé à la notoriété littéraire que par suite d'une invraisemblable faute de goût commise, il y a quelques années, par des critiques déboussolées. Mes provocations poussives ont depuis, heureusement, fini par lasser."
C'est ainsi que Houellebecq ouvre le feu dans cette correspondance avec BHL, publiée sous le titre Ennemis Publics et annoncée comme un des grands coups littéraires de cette rentrée. Maintenant on peut lire à peu près partout que les ventes ne sont pas à la hauteur des espérances (tirage de 150 000 pour des ventes qui n'atteignent pas encore les 40 000), et je ne vois d'ailleurs rien de bien étonnant là-dedans : j'ai été surpris qu'on table sur un immense succès pour ce genre de livre, surtout de la part de deux écrivains qu'on voit souvent et qui s'attirent de nombreux commentaires sur leur vie privée. Comment espérer susciter dans ces conditions de véritable curiosité ?
Pourtant je me suis jeté sur le volume, en bon fan de Houellebecq et en lecteur régulier de BHL. Je l'ai lu d'une traite, à la fois saisi par l'évidence de leurs proses respectives (style fluide et solennel de BHL, celui qu'il a dû se forger dans ses copies de philo de Khâgne, et plume toujours aussi délicieusement désinvolte et pince-sans-rire de Houellebecq, avec des touches de gravité parfaitement bien senties), et impatient de voir où le livre nous menait exactement.
La réponse est qu'il ne mène pas vraiment quelque part, le titre indiquant un thème, celui de l'hostilité que tous les deux s'attirent, auquel les deux auteurs ne consacrent qu'une poignée de pages. Il s'agit en fait pour eux de préciser leurs positions philosophiques respectives, et de faire le point sur quelques données biographiques parfois malmenées par la critique. Certaines pages sont savoureuses, par exemple quand Houellebecq précise son rapport à la France :
"Jamais je ne me suis senti de devoir, ni d'obligation, par rapport à la France, et le choix d'un pays de résidence a pour moi à peu près autant de résonance émotive que le choix d'un hôtel. Nous sommes de passage sur cette Terre, je l'ai maintenant parfaitement compris ; nous n'avons pas de racines, nous ne produisons pas de fruit. Notre mode d'existence, en résumé, est différent de celui des arbres. Cela dit j'aime beaucoup les arbres, je les aime même de plus en plus; mais je n'en suis pas un. Nous serions plutôt des pierres, lancées dans le vide, et aussi libres qu'elles ; ou, si l'on tient absolument à voir les choses du bon côté, nous serions un peu comme des comètes. (...)
Il se peut que je revienne un jour en France, et ce sera pour une raison très simple : j'en aurai assez de parler et de lire en anglais, dans ma vie quotidienne. Ca m'énerve un peu de manifester cet attachement à ma langue, je trouve que ça fait posture d'écrivain ; mais c'est la vérité. (...)
Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la France de Denis Tillinac - départementales et confit de canard. (...) Nous avons affaire à un très beau pays. Ces paysages ruraux, avec la subtile alliance de champs cultivés, de prairies et de bois. Les villages au milieu, la pierre des maisons, l'architecture des églises. Tout ceci changeant vite, en cinquante kilomètres on découvre une autre composition, tout aussi harmonieuse. C'est incroyablement beau, ce qu'ont réussi à faire, au cours des siècles, des générations de paysans anonymes." (Extrait de Ennemis Publics, pp 122-124)
Mais le plus surprenant, le plus saillant reste bien la page d'ouverture... Quel est le degré de sincérité de ce double portrait qui doit ravir tous ceux que nos deux auteur exaspèrent ? Quelle part de jeu, de provocation ?
Ne fallait-il pas un vrai goût du risque pour que BHL laisse passer dès les premières lignes une satire aussi mordante ? Lui qu'on dépeint souvent comme un homme dépourvu d'humour fait preuve ici d'un détachement qui ressemble fort à un coup de poker, un pied de nez à toutes les moqueries. Le rêve aurait été que tout le livre soit de cet acabit...